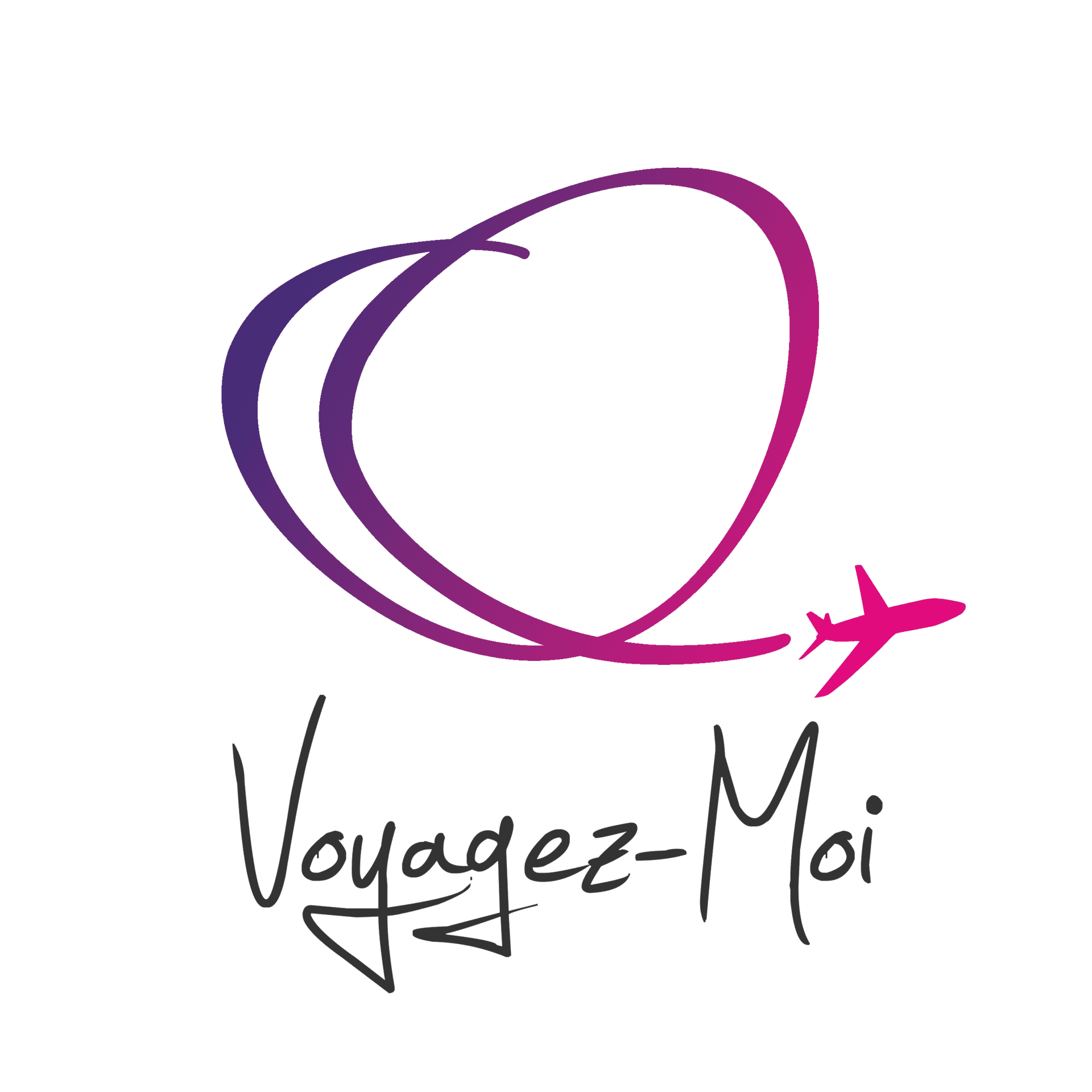Bali en fête à l’occasion du Nouvel An Balinais

Le
cortège s’échelonne sur plusieurs centaines de mètres et progresse
tranquillement. Beauté et sérénité se dégagent de cette houle blanche qui coule
sur l’asphalte. Des bannières et des parapluies multicolores se balancent au
milieu de ce moutonnement humain. Un étrange animal comme une sorte de monstre
à quatre pattes se dandine au milieu d’hommes portant chemise blanche et sarong
à damier à carreaux noirs et blancs. Des gongs et des métallophones nimbent
l’atmosphère d’une musique syncopée parfois striée par le son d’une flûte...
Nous sommes le mercredi 4 avril 2017. C’est jour de Galungan.

Amis voyageurs, votre ouverture d’esprit, votre curiosité à l’égard d’autres cultures constituent des moteurs pour découvrir l’autre et des horizons nouveaux. Alors, si vous avez la possibilité de choisir la date de votre séjour à Bali, nous vous conseillons de venir lors d’un événement étonnant, le passage au nouvel an balinais, le Galungan.
Vous serez témoins d’un spectacle haut en couleurs sur l’ensemble de l’île qui sera en fête pendant une dizaine de jours. Vous pourrez vous immerger dans cette culture unique et flamboyante avec une ambiance colorée et festive.
Le calendrier balinais est sophistiqué. Coexistent deux systèmes. Le Pawukan, une année comptant 210 jours et le Saka organisé autour de la nouvelle lune.
Le Pawukan est divisé en semaines selon un schéma complexe, le Saka en mois.
Le Pawukan est le plus connu. Il est utilisé pour fêter Galungan, toujours un mercredi.
Ce moment marque l’entrée dans la nouvelle année.
Pendant 10 jours et ce, tous les 210 jours, le temps est suspendu à Bali. L’activité de la population balinaise se concentre sur la préparation et le déroulement du Galungan. Cette période s’achève avec le Kuningan, toujours un samedi.
Même l’activité dans les rivières, pourtant essentielle, est ralentie.
Cette année, ce moment se déroule du 30 mai au 9 juin 2018 et du 26 décembre 2018 au 5 janvier 2019. L’année prochaine le Galungan débutera en pleine saison touristique du 24 juillet au 3 août 2019.
On trouve son origine dans la création de l’univers et la victoire des forces du bien contre celles du mal, en clair la victoire de Dharma le bon contre le méchant Adharma.
Mais une autre légende circule sous la forme d’un combat entre le roi Mayadenawa et le dieu Indra. Le roi cruel aurait interdit aux balinais de fêter leurs dieux et ancêtres. Indra, pris de compassion, proposa son aide, et en dépit des pouvoirs magiques du roi, finit par l’occire !
Je ne trancherai pas, c’est le propre des légendes…
5 jours avant la date du Galungan, les dieux descendent sur terre et les âmes des ancêtres rejoignent le foyer de leurs descendants. Dieux et ancêtres resteront 10 jours pour retourner dans les cieux 5 jours avant le Kuningan, jour de purification.
A cette occasion, les salariés balinais jouissent de 3 jours de congé du mardi au jeudi, encadrant le mercredi, jour de Galungan.
Cette fête du nouvel an balinais est l’occasion de retrouvailles pour l’ensemble des membres des familles. Chacun joue le jeu lors du Galungan, y compris ceux qui sont, par leurs études ou leur activité professionnelle, relativement éloignés du quotidien traditionnel des villages.
Les jours précédant le Galungan tout le monde est mobilisé, enfants y compris, pour participer à l’organisation des festivités. Cette fête est en effet celle qui exige le plus de préparatifs qui commencent 5 jours avant Galungan par une cérémonie de purification ( Sugian Jawa).
Les hommes sont affectés au repas et à la création des penjors alors que les femmes s’occupent des offrandes.
Les penjors sont de longues perches en bambou disposées en face de chaque habitation. Ils sont richement et abondamment décorés. Ces penjors symbolisent le sommet des montagnes où résident les dieux, comme le volcan Gunung Agung. La queue garnie d’offrandes retombe vers le sol, peut-être un clin d’œil à l’égard de la queue du Barong !


Un petit autel disposé à proximité ou au pied du Penjor (Sanggah Penjor) recueille des offrandes et une bande de feuilles de palmier et de cocotier tissées souvent de couleur verte et jaune et à motifs se déroule comme une bannière. C’est le lamak omniprésent dans le système sophistiqué des offrandes.

La préparation des offrandes se fait quelques jours avant le jour de Galungan.
La veille du Galungan on procède à la mise à mort des porcs et des poulets.
La scène peut choquer mais elle fait partie du rituel sans état d’âme pratiqué par les balinais.
Le porc vivant peut être attaché à un bambou que l’on porte à deux mais il peut être aussi enfermé dans une cage les pattes attachées pour éviter les ruades. Celui sur la photo fait son poids : 120 kg.
La gestuelle de la mise à mort est précise et rapide. Le couteau entaille la gorge, le sang se déverse dans une bassine. Il servira à faire du boudin. Le porc passe ainsi rapidement de vie à trépas.
La deuxième opération consiste à laver le porc avec une brosse et à raser les poils à la machette.

Puis le couteau fouraille entre les pattes arrière pour en retirer les entrailles et les déposer sur l’abdomen du porc.
Le porc fera un plat connu le babi guling. Cuit à la broche pendant de longues heures et farci d’épices, d’ail, de gingembre, le cochon ainsi rôti est un mets particulièrement apprécié des balinais.
Pour ce moment incontournable aux cérémonies, âme sensible s’abstenir ainsi que les personnes sensibilisées à la souffrance animale.
Pratique identique pour la volaille. Un stylet en bambou est enfoncé en un endroit précis de la gorge du poulet ou du canard. Le sang est recueilli dans une écuelle. Puis le volatile est jeté au sol. Après quelques soubresauts, il expire. Plongé dans l’eau bouillante le poulet sera déplumé et débité.
Les morceaux sont hachés menu à l’aide d’une petite machette. Cette opération prend du temps. Lorsque la viande est réduite à l’état de pâté, on le dispose autour d’un bâtonnet en bambou pour en faire des brochettes prêtes pour une cure d’eau bouillante. C’est le saté.
Les demeures familiales sont le lieu aussi de cérémonies et de dépôt d’offrandes dans des endroits ou des lieux parfois improbables, ustensiles de cuisine, capot d’une voiture, selle d’une bicyclette, ordinateurs…

Les temples accueillent une multitude d’offrandes, Banten étant le terme générique pour les désigner. Mais les formes et les couleurs sont d’une variété infinie. Chacune porte un nom. Leur composition est très diverse parfois baroque : fleurs, fruits, poulets, pièces de monnaie, feuilles de palmiers, tiges de bambou, pâtes de riz parfois peintes…


L’image d’Epinal des balinaises portant sur leur tête une pyramide d’offrandes pouvant atteindre 2 mètres de haut recueille toujours autant de succès auprès des touristes photographes.
Mais la plupart du temps ce sont des paniers en fibres tressées et décorés ou un support spécifique, le Tulang, qui sont utilisés pour l’apport des offrandes au temple.
Le génie balinais excelle dans la confection de ces offrandes qui vont résider dans les temples pendant toute la cérémonie. La gestuelle et les techniques de fabrication des offrandes sont tellement bien acquises que même aveugle la balinaise aura le geste précis et naturel tout en conversant avec ses amies. Ces offrandes regagneront ensuite les demeures des familles où les parties comestibles seront dégustées. Certaines seront aussi laissées aux prêtres.
C’est toujours étonnant de voir cette féerie et cette explosion des couleurs au service d’une spiritualité solide et affirmée.

Les balinais en habits de cérémonie se regroupent dans les temples. Des prêtres, les pemangkus, officient pour bénir les participants et les offrandes.
En la circonstance, les statues et les Balés ( plateformes ouvertes avec des piliers sur lequel repose un toit de chaume ou de tuiles) sont ceints d’un tissu jaune ou blanc couleurs du sacré.


Les prêtres aspergent les balinais d’eau lustrale qui est recueillie sur les paumes ouvertes comme un réceptacle. Les pèlerins mouillent la bouche, le front, la tête. Une fleur de frangipanier entre les doigts des deux mains jointes, ils s’inclinent à trois reprises en élevant les mains au niveau de la poitrine, de la face et de la tête.

Le cérémonial est codifié. Modernité oblige, les prêtres utilisent désormais le micro pour mener la prière.
Plusieurs orchestres de composition différente accompagnent la cérémonie. Le gamelan, nom générique pour désigner un ensemble instrumental , comprend une diversité d’instruments : les gongs de différentes tailles, chacun portant un nom propre, les tambours qui donnent le rythme, des séries de métallophones qui créent un volume musical étonnant, une rivière sonore syncopée, des alignements de gongs sur un socle en bambou, des flûtes, des cymbales.

L’orchestre Gong Gede qui accompagne les danses martiales comme le Baris Gede ou Presi dégage une puissance et une profondeur qui incarnent bien la majesté de la cérémonie. Des danses sacrées comme le Rejang se déroulent dans l’enceinte du temple.



Mais le moment le plus important qui tranche avec les cérémonies traditionnelles arrive au moment où le Barong sort du temple, une fois l’an à l’occasion de cette fête, pour déambuler dans les rues du village ou du bourg. Ce sont uniquement les hommes habillés de blanc, couleur sacrée avec le jaune, le kriss à la ceinture, qui vont suivre la promenade du Barong, animal mythique, à tête léonine, hirsute, symbole du bien mais aussi d’une certaine puissance.
Délaissant son combat bien connu avec Rangda, mis en scène lors de séquences jouées pour les touristes ou lors de fêtes de temple, la sorcière porteuse de magie noire, le Barong joue ici le rôle protecteur de la communauté. Le Barong symbolise aussi le soleil, la lumière, l’antidote contre les mauvais esprits. Les cérémonies de purification qui ont lieu témoignent du souci constant des balinais de maintenir avant tout l’harmonie en composant aussi bien avec les forces du mal que du bien. Par la purification, l’objectif est de restaurer ou de maintenir un équilibre nécessaire au bien-être de la communauté.
L’origine du Barong est incertaine mais on pense que son existence préexiste à l’arrivée de l’hindouisme et du bouddhisme dans l’île. C’est le propre de l’âme balinaise de digérer et de faire siennes les influences extérieures. Cela donne une religiosité particulière où il est parfois difficile de faire le tri entre les usages, les coutumes, les rites.
C’est un spectacle à la fois majestueux et surprenant - mais qui connaît les us et coutumes de Bali ne s’en étonnera pas - de voir ce fleuve blanc progresser lentement à travers les rizières et le long des rues à la suite du Barong accompagné par de la musique de gongs et de métallophones accrochés à une perche en bambou.


La notion de communauté fait partie de l’âme et de l’organisation sociale des balinais. C’est une fête collective, parfaitement organisée où les rôles sont bien compris et respectés. Ainsi, lors de la déambulation du cortège autour du Barong, des balinais, font la police lorsqu’il aborde un axe routier encombré de camions, de voitures ou de motos.
Le Barong peut encore quitter sa demeure pour rejoindre un temple situé ailleurs où d’autres Barongs issus d’autres villages seront exposés dans l’enceinte d’un temple.
Le spectacle est étonnant. Le Barong est hissé sur la plateforme ouverte d’un camion entouré de ses servants.
Je suis assis à côté du conducteur, mon vieil ami Nyoman, dans un véhicule qui suit le camion. Derrière moi des chants s’élèvent dans l’habitacle. Deux balinaises au micro avec deux voix mâles en écho déversent des chants sacrés amplifiés par un haut-parleur installé sur le toit du véhicule.

Derrière une meute de motos forment un cortège bruyant mais pittoresque. Les habitants des villages traversés se postent le long de la route pour accompagner du regard l’animal bienfaiteur.

La foule est dense. Ici, elle provient de trois villages. Le temple fourmille d’offrandes, les femmes s’agenouillent, les hommes s’assoient en tailleur. Les prêtres vont et viennent, s’affairent autour des 3 barongs, un par village, disposés côté à côte comme des frères issus du même ventre cosmique.

C’est le moment de la purification et de la prière. Les nombreux prêtres déambulent parmi la foule des pèlerins pour les asperger d’eau lustrale.
Moment empreint d’une solennité et d’une simplicité toute balinaise.

Les Barongs font l’objet de toute l’attention des prêtres. Ainsi, le regard amusé et surpris que je porte à l’égard d’une procédure incongrue que celle du prêtre qui manipule la mâchoire inférieure du BARONG pour y enfourner de la nourriture. Les dieux comme les ancêtres sont des invités. Il faut les choyer …



Les Barongs regagneront par la suite leur demeure située dans la partie la plus sacrée du temple. Ils y resteront jusqu’au prochain passage à la nouvelle année selon le calendrier Waku.
Cette période de 10 jours s’achève toujours un samedi avec le Kuningan dérivé du mot Kuning ( couleur jaune en indonésien). C’est encore l’occasion de dépôt d’offrandes avec notamment du riz teint en jaune, de danses et de combats de coqs qui sont une tradition vivace dans la culture balinaise. On brûle aussi les offrandes devant les maisons.

Avouons-le, j’ai toujours été circonspect à voir les sommes importantes pariées lors des combats de coqs. C’est une affaire d’hommes. La passion qui y est mise est proprement étonnante.


L’organisation est prévue dans les moindres détails. La foule massée autour de l’aire de combat brandit des billets de banque pour parier sur le coq choisi. L’ambiance est enfiévrée. Accroupi dans la position classique asiatique le propriétaire du coq qui va combattre prépare son coq au combat. Il lui souffle dans le bec pour lui donner de l’énergie, lui masse le bas du cou.

Les deux adversaires s’observent. Parfois le combat est rapide lorsqu’un des combattants réussit lors de la première empoignade à enfoncer la pointe du taji dans le coeur. Si la lutte est incertaine ou si un des coqs refuse le combat, on les mets dans une cage…l’issue sera rapidement fatale, parfois pour les deux combattants !

Danses, musique, théâtre se déroulent traditionnellement pendant cette journée de clôture de cette période de 10 jours.
La modernité fait son entrée avec la sonorisation des spectacles et l’utilisation du micro. Ce recours à la technologie du son irrigue aussi les moments cérémoniels lors notamment de la prière collective et de la purification. Une voix au micro guide les balinais dans l’accomplissement du rituel.
J’ai pu en avril 2017 assister à une représentation d’une pièce théâtrale populaire mélange de farce, de comique et de grivoiserie.

La nuit est sans lune. Le public balinais est bon enfant. Une des actrices descend parmi la foule des spectateurs pour jeter son dévolu sur un balinais et l’inviter à monter sur scène. Mais les hommes désignés s’enfuient ou refusent !
Je me suis fait tout petit assis au pied d’un pilier soutenant le vaste préau sous lequel le spectacle a lieu. Mais, lorsque la balinais m’a repéré j’ai compris… Elle me prend par la main pour monter sur la scène. Les balinais s’esclaffent et une houle de rires, d’exclamations et de commentaires traverse l’espace.
Je tente maladroitement de faire bonne figure, esquisse quelques pas de danse, me lance dans des gesticulations puisées dans mon expérience vécue 45 ans auparavant. A cette époque il m’est arrivé d’évoluer avec une jeune partenaire balinaise pour la danse de séduction, le Joged Bumbung.


Lors de mes rencontres avec Kusama ma partenaire des temps anciens nous évoquons souvent avec amitié et rires cette période lointaine.

Les rides sont bien là mais la fraîcheur et la spontanéité des relations subsistent toujours. Une phrase me revient, celle du titre d’un roman de Simone Signoret « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était » ! Tout est dit.
Si d’aventure vous êtes amenés à vous trouver dans de telles circonstances, n’hésitez pas. Laissez-vous aller et jouer le jeu. Les balinais adorent.
A bientôt mes amis pour ouvrir d’autres fenêtres sur Bali.